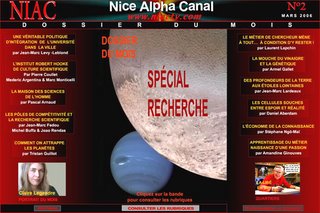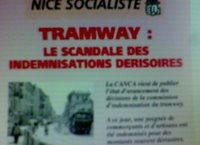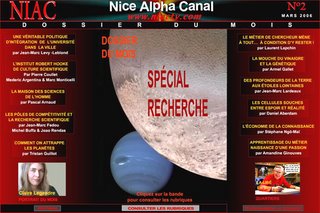
Pour sa deuxième livraison, Nice Alpha Canal consacre son dossier du mois à la Recherche.
Au moment où la loi, paradoxalement intitulée « pacte pour la recherche » est votée par le Parlement contre l’avis unanime de la communauté scientifique, il était important de faire le point sur cette question qui, avec l’éducation, l’énergie et l’évolution de la dette publique, sera au centre de la campagne présidentielle, si les candidats se décident enfin à parler d’avenir.
Mais au delà de la question générale de la recherche, il est également utile de s’interroger sur son avenir dans notre département et dans notre ville.
La recherche scientifique à Nice, c'est 13 grands organismes et établissements : l'Université de Nice Sophia Antipolis, le CNRS, l'lNRA, l'INRIA, l'Observatoire de la Côte d'Azur, l'INSERM, l'Ecole des Mines de Paris, l’Observatoire Océanologique de Villefranche, et bien d'autres instituts encore.
C’est aussi 4000 permanents, dont près de 3000 chercheurs, enseignants-chercheurs et doctorants, qui travaillent dans ces laboratoires de recherche, dans des domaines aussi variés que la biologie, la santé, la physique, la chimie, les matériaux, les énergies, les mathématiques, l'informatique, l'électronique et les communications , l'environnement, les sciences de la Terre et de l'Espace, les sciences de l'hommes et de la société, les lettres et arts, l'économie, le droit, la gestion, les sciences des activités sportives, etc.
Il existe également une recherche très active dans les entreprises implantées dans notre région (santé, informatique, télécommunications, etc).
Il est donc bien évident que le "dossier recherche" de Niac ne pouvait rendre compte de tous les aspects de cette recherche. Nous avons donc choisi de mettre l'accent sur la recherche fondamentale, car elle est le socle sans lequel il ne peut y avoir d'application de la recherche. Cette recherche fondamentale doit être défendue, au niveau national et international mais aussi dans le cadre de nos politiques locales et régionales. Il existe ainsi, dans notre département, des chercheurs de renommée internationale, qui travaillent entre autres exemples sur la mouche du vinaigre, sur les planètes géantes, sur l'histoire "romaine" de notre région, sur les mouvements de la Terre, sur la génétique des populations ou encore sur les cellules souches, toutes choses fondamentales mais, le plus souvent, non directement "applicables". Dans Niac, ils expliquent leur vision de leur métier, ses joies, ses difficultés, ainsi que son évolution, qui ne va pas toujours dans le sens souhaité. Mais tous s'accordent à dire qu'il n'y a pas de politique de recherche ambitieuse et viable sans recherche fondamentale forte.
Bien sûr, l'innovation technologique et le développement doivent être favorisés, parce qu'ils sont créateurs d'emplois et de richesse, mais cela ne doit pas être fait au détriment de la science elle-même, qui a des besoins bien différents. L'innovation et le développement peuvent notamment passer par les pôles de compétitivité, en cours de développement dans notre région et dans le reste de la France, mais à condition d'éviter les écueils du "tout appliqué" et du "tout brevetable", et à condition aussi de ne pas utiliser les budgets de la recherche fondamentale pour les financer.
Enfin, beaucoup de chercheurs interviewés par NIAC s'inquiètent de ce que, trop souvent, les décideurs locaux et nationaux, comprennent mal ce qu'est la science, la recherche et ses besoins. Développer la culture scientifique, faire découvrir l'histoire des sciences et la démarche scientifique à des élèves du secondaire mais aussi à un public plus large pourrait améliorer cette compréhension. C'est ce que propose une nouvelle structure de l'Université Nice Sophia-Antipolis, l'Institut Robert Hooke. Mais il faudrait sans doute, d'une manière plus générale, développer dès à présent les interactions entre chercheurs et autres citoyens, replacer les laboratoires et leurs métiers dans la ville et son environnement, comme le conseille le physicien et philosophe Jean-Marc Lévy-Leblond.